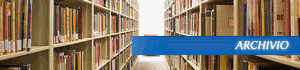L’héritage de Draghi ? En bref : on a, encore, l’euro
 « Il est difficile d’oublier l’empire », une conversation avec Romano Prodi
« Il est difficile d’oublier l’empire », une conversation avec Romano Prodi
Propos recueillis par Gilles Gressani avec Romano Prodi sur Le Grand Continent du 18 octobre 2019
Nous avons rencontré Romano Prodi, économiste, deux fois à la tête du gouvernement italien, président de la Commission européenne. Du sens politique du rejet de Sylvie Goulard à la signification de la doctrine Xi Jinping, de l’aspect freudien du Brexit au césaropapisme de la gestuelle de Salvini, une perspective globale sur notre moment politique par l’une des grandes figures de l’histoire contemporaine.
Nous aimerions commencer par vous demander de partager avec nos lecteurs votre analyse du contexte politique continental contemporain. Comment interprétez-vous le rejet de la candidature de Sylvie Goulard ?
Je connais Sylvie Goulard depuis longtemps, elle était ma conseillère politique quand j’étais président de la Commission. Sa valeur est incontestable et elle connaît très bien les institutions européennes. Par son niveau intellectuel et opérationnel, il s’agissait de l’une des rares candidates capables d’assurer l’extrême complexité de la fonction à laquelle elle avait été appelée. En ce sens, je dois dire que j’ai été très surpris. Bien sûr, je n’ai pas beaucoup d’informations et je n’avais pas suivi les précédents français. Mais j’ai l’impression en observant la façon dont se sont structurés les débats parlementaires qu’il s’agissait plutôt d’un affrontement politique que du rejet d’une candidature. Sa valeur n’est mise en doute par personne, et je peux en témoigner.
Quels éléments ont le plus pesé dans son rejet ?
Je pense que c’était une sorte de vengeance. Sylvie Goulard était la candidate du président Macron et elle a fini par être assimilée à l’initiative qui l’a conduit à trouver un consensus avec la chancelière allemande à propos des nominations, en court-circuitant le Parlement européen, et notamment en contribuant à l’échec du système du Spitzenkandidat.
La présentation d’une autre candidature aurait-elle eu des conséquences différentes selon vous ?
Je ne peux pas en être entièrement sûr parce que je ne connais pas parfaitement le dossier, mais je crois vraiment que la grande majorité des suffrages qui ont conduit au rejet de Goulard ont été donnés pour des raisons politiques. Le Parlement, privé des larges pouvoirs qu’il devrait avoir, prend sa revanche comme il peut et frappe là où il peut faire le plus de mal. C’est un peu comme avec la guerre commerciale, pourquoi Trump frappe-t-il le parmesan en Italie1 ? Parce qu’il sait que c’est là qu’il la blessera le plus.
Quel est selon vous le sens politique de cette séquence ?
On est confronté à un geste qui a de lourdes conséquences qui me préoccupent. Il pourrait nuire aux relations entre le président Macron, la chancelière Merkel et le Parlement européen, ce qui n’est pas du tout souhaitable aujourd’hui. En effet, malgré les critiques formelles à l’égard des nominations, la résolution que nous avions obtenue concernant les nominations aux top jobs m’a semblé absolument positive pour l’Union. Un cadre très complet se profilait, compétitif et prêt à avancer.
En quel sens parlez-vous d’une rupture franco-allemande ?
Avec ces nominations, l’alliance entre la France et l’Allemagne avait de nouveau pris forme et c’est la condition nécessaire, mais certainement pas suffisante, du progrès européen. Ces dernières années, malgré les réunions, les compromis, les projets communs, les relations de la France avec l’Allemagne n’ont pas été harmonieuses et l’Union en a certainement souffert.
Ne voyez-vous pas un élément positif dans cette tentative de parlementarisation de la politique européenne ?
Oui, le rôle croissant du Parlement européen est absolument positif. Je pense même que le Parlement devrait avoir une capacité de proposition qu’il n’a pas eue jusqu’à présent. Sans un Parlement réel, on n’aura jamais une Union politique réelle. Simplement, que se passe-t-il ? L’examen des commissaires est l’un des rares pouvoirs exclusifs clairs dont dispose le Parlement et il finit par l’utiliser le plus largement possible, précisément parce que c’est l’un des rares pouvoirs dont il dispose réellement.
On parle même de la possibilité que le Parlement européen rejette la Commission…
Non, ce n’est même pas une possibilité. La Commission sera certainement confirmée, notamment parce que politiquement son rejet n’aurait aucun sens : après avoir arrêté les candidats qui n’étaient pas souhaitables, il ne reste que les candidats qui ont été approuvés…
Ursula Von der Leyen, cependant, a été élue sur le fil du rasoir….
Oui, mais la faible majorité avec laquelle Von der Leyen a été approuvée découle également de la manière dont elle a été choisie. Une partie très importante des opposants à sa candidature sont des européistes convaincus, peut-être même plus convaincus que ceux qui ont voté pour elle, et je ne vois donc pas pour l’instant la possibilité d’une crise institutionnelle de cette ampleur.
Le fait politique d’un parlement capable de jouer le rôle d’une fronde ne vous semble-t-il pas souligner par contraste que le barycentre institutionnel de la politique européenne est de plus en plus clairement concentré dans le Conseil ? Que pensez-vous de cette tendance ?
Je suis d’accord avec cette analyse. Il s’agit, à mon sens, de l’un des éléments néfastes de l’Europe contemporaine. J’observe que tant que la Commission était le point de référence, elle prenait de grandes décisions et les peuples aimaient l’Europe. Même lorsqu’elle prenait des décisions contrastées, comme le projet de Constitution, l’élargissement ou la mise en œuvre de l’euro, les citoyens voyaient en elle un organisme protecteur. La désaffection généralisée pour l’Europe a coïncidé avec le moment où le rapport de force a basculé de la Commission au Conseil. Qu’il y ait là une corrélation ou même une causalité, je ne saurais pas le dire, mais il y certainement une coïncidence intéressante.
En quel sens ?
L’Europe doit protéger, elle doit donner des garanties au citoyen. Elle doit faire, construire, rendre possibles des choses qui donnent à l’Europe un rôle dans le monde. S’il ne le fait pas, les citoyens l’abandonnent et c’est ce qui s’est passé ces dernières années. Le Conseil ne fait rien d’autre que des compromis instables qui, dans de nombreux cas, sont paralysants ou à la baisse. Et la désaffection pour cette action hésitante ne peut que grandir. Par ailleurs, les dernières grandes décisions européennes ont été prises par la BCE et certainement pas par le Conseil…
À ce propos, comment qualifieriez-vous le rôle joué par la Banque centrale ces dernières années ?
La BCE a été une excellente suppléante. Par son action elle a empêché l’effondrement de l’euro. Attention, cependant, la BCE n’est pas un organisme démocratique. Les autres institutions, bien qu’on puisse leur reprocher d’être indirectes ou de second degré, sont réellement démocratiques. Donc, si nous pouvons être reconnaissants du rôle joué par la BCE, nous devons également comprendre qu’une suppléance est provisoire et doit finir par être remplacée.
Que pensez-vous de l’héritage de Draghi ?
En bref : on a, encore, l’euro.
Mais quelles sont les perspectives de cet héritage ?
C’est une question importante. Nous assistons à une évolution intéressante, l’euro est en train de prendre de l’ampleur. Cela prendra du temps, peut-être beaucoup de temps, mais il y a de plus en plus de pays qui critiquent le rôle dominant du dollar. Bien sûr, ce rôle reste très important, mais il convient de noter qu’il n’a pas été remis en question tant que les États-Unis ont eu une politique étrangère claire et définie et donc forte. Une chance pour l’euro s’ouvre aujourd’hui dans le chaos d’une politique qui se veut simplement forte.
Dans les dernières années, les réserves en dollars ont légèrement baissé dans le monde, de quatre points selon Goldman Sachs, et se situent donc autour de 60 %2. Le simple fait qu’il y ait eu un achat continu et généralisé d’or, une sorte de grande assurance, est au fond un fait d’une importance considérable, un grand changement qui donne une chance au rôle de l’euro comme monnaie de référence. Dans les faits ni le yen ou la livre n’ont l’importance adéquate et le renminbi ou le rouble ne sont pas encore convertibles.
Vous étiez président de la Commission lors de l’introduction de l’euro, pensez-vous qu’il y a eu un changement dans la perception du rôle géopolitique de l’euro ?
J’ai une anecdote intéressante à ce sujet. Lors de la réunion où j’ai présenté l’euro à la Chine, le Premier ministre chinois a exprimé son approbation inconditionnelle pour une raison qui s’est révélée intéressante, à savoir que s’il y a l’euro à côté du dollar, il y aura aussi une place pour le renminbi dans l’avenir. Cet avenir ne s’est pas encore tout à fait réalisé, mais nous nous rapprochons à grands pas et cela donne à l’euro un rôle sans précédent.
Ce potentiel survient à un moment de bouleversement de l’infrastructure internationale. Ursula von der Leyen a déclaré que sa Commission devait être « géopolitique » – ce mot ne devait pas être très utilisé quand vous étiez à sa place à la tête de la Commission ?
Je suis vraiment surpris. Je n’avais jamais entendu cette définition auparavant. Mais si la géopolitique signifie que l’Europe doit retrouver un rôle dans le monde, je suis tout à fait d’accord. Premièrement, parce que nous avons la taille, les moyens et la possibilité. Nous sommes toujours le numéro un mondial de la production industrielle et le numéro un des exportations. Nous avons donc le devoir de jouer un rôle géopolitique. Et si je ne crois pas que ce soit impossible, je pense que ce n’est pas évident non plus. Ce n’est pas impossible parce qu’on ressent qu’entre la Chine et les États-Unis on a besoin d’un médiateur, d’un pouvoir tampon…
L’Union devrait donc jouer un rôle quasi katechontique, en devenant un pouvoir qui retient ?
Oui, tout à fait. Un pouvoir qui calme le jeu, qui ramène la rationalité. Je suis convaincu que cela ne sera possible que si nous limitons l’unanimité, si nous donnons le pouvoir à une instance capable de gouverner, c’est-à-dire à la Commission, et si nous commençons à mettre en œuvre les politiques qui ont toujours été reportées.
Quand vous parlez d’exportations, vous parlez de géoéconomie, ou du moins d’une projection de pouvoir qui passe par un pouvoir normatif – mais n’y a-t-il pas un manque de moyens, de leviers, de hard power, pour exprimer une fonction géopolitique complète ?
Oui, pour cette raison pour moi la défense commune est le premier objectif à entreprendre avec des étapes réalistes et sans multiplier les dépenses. Vous n’avez pas à dépenser plus, au contraire, vous devez créer rapidement la structure de l’armée, économiser de l’argent, intégrer. Nous produisons des variantes et des complications infinies pour le moindre équipement militaire en Europe, alors que les États-Unis savent faire des économies d’échelle. Toutefois, je ne pense pas que l’Europe doive devenir une superpuissance, simplement nous avons besoin d’une armée capable de jouer un rôle régional important.
Qu’entendez-vous par régional ?
La Méditerranée, le Moyen-Orient méditerranéen, par exemple, en feraient partie.
Le problème, c’est que dès que des points concrets sont abordés, des différences substantielles émergent. Le cas libyen est un exemple avec une réelle divergence entre la France et l’Italie….
C’est vrai, pour être géopolitique, il faut avoir une dialectique et un centre de décision. L’objectif de la défense commune est une priorité pour la définition d’une politique étrangère.
Mais ce centre de décision peut-il réellement se situer dans les institutions actuelles, à la Commission ou dans la fonction du Haut représentant ?
Il doit y avoir de nombreuses étapes intermédiaires, mais le jeu de la Commission et du Parlement doit être l’objectif final. Lorsque j’étais président, j’ai connu une crise majeure au sein de la Commission, qui à l’époque disposait encore d’une réelle capacité de leadership, à cause de la division provoquée par la guerre en Irak. C’était une tension beaucoup plus forte qu’on ne le pense ou qu’on ne l’a racontée par la suite.
En quel sens ?
Elle a produit une grande dialectique entre la Commission et les États membres. Des compromis qui étaient possibles sont soudainement devenues extrêmement difficiles à envisager. Sans oublier que la guerre en Irak a été le début d’une série de tensions au Moyen-Orient, qui ont vu une progressive perte d’influence de l’Europe. Pensez à l’énorme influence perdue de la France en Syrie. Je me souviens être allé avec Chirac aux funérailles d’Assad père. C’était très clair, le pays voyait en Chirac un grand point de référence historique, culturel, politique. Ces dernières années, il y a eu une rupture complète, et dans les conflits syriens qui ont suivi, la France n’a compté pour rien, comme l’Europe.
Comment expliquer ce déclin ?
La division. La division et la nostalgie impériale. Vous savez, il est difficile d’oublier l’empire. Il y a une nostalgie généralisée de la grandeur qui a des effets centripètes et qui produit un profond ressentiment et un imaginaire incapable d’articuler des propositions qui résistent à l’épreuve des faits. Prenez le Brexit, qu’est-ce que c’est si ce n’est pas, après tout, un truc freudien, un acte de profonde nostalgie de l’empire ? Le problème du Brexit n’est pas la Grande-Bretagne ou l’Europe, le problème, c’est Freud.
Comment sortir de cette impasse ?
L’histoire ne se résume pas à des triomphes. Au contraire, les défaites nous enseignent parfois encore plus. Le Royaume-Uni finira par partir, mais je suis prêt à parier que dans dix ans, il reviendra. Entretemps nous devons nous ressaisir. Nous avons la possibilité, certainement pas la certitude, mais la possibilité, de restaurer une structure de direction franco-allemande de l’Europe qui, à mon avis, a été interrompue ces deux dernières années. Il y a eu une sorte de division du travail selon laquelle la France s’est consacrée à la politique étrangère et l’Allemagne à la politique économique, rejetant de fait toute proposition substantielle faite par Macron. Aujourd’hui, nous avons la possibilité d’une reprise grâce aussi au rôle de l’Italie.
L’Italie peut-elle jouer un rôle de premier plan dans la politique continentale ?
Attention, l’Italie n’a jamais été le leader de l’Europe, mais j’ai toujours considéré que c’était un ciment nécessaire pour que l’Europe prenne des décisions véritablement partagées. Je pourrais revenir en arrière dans l’histoire pour prouver cette constante dans l’histoire européenne. C’est notre rôle compte tenu de l’équilibre des pouvoirs qui s’est dégagé de la Seconde Guerre mondiale et qui a caractérisé les années d’intégration européenne qui ont été interrompues pendant un an avec la Ligue et qui peuvent maintenant être restaurées.
En ce qui concerne la Ligue, vous êtes entré en politique dans la Démocratie chrétienne réformiste de Beniamino Andreatta. Comment comprenez-vous l’utilisation fréquente de références chrétiennes par Matteo Salvini qui avait consacré, par exemple, sa campagne électorale européenne à la Sainte Vierge et qui utilise le rosaire dans ses meetings ?
Il n’y a absolument aucune relation entre Salvini et les Démocrates-chrétiens qui ont toujours été très reservés dans leur utilisation des symboles chrétiens. La Democrazia Cristiana a certainement et largement utilisé l’Église et sa capacité d’organisation mais n’aurait jamais rêvé de faire ce genre de salvinades. Ceux qui auraient osé prendre un chapelet dans leurs mains lors d’un meeting auraient pris des coups de bâton.
Salvini a reçu des critiques de la part de personnalités du Vatican….
Absolument, mais cela arrive surtout parce qu’il y a un Pape qui prône l’universalité absolue et qui s’oppose par conséquent à la nationalité de l’Église. C’est très intéressant, chaque décision, chaque déclaration de François va vers l’universalisme. Cela va de l’unité que nous devons avoir à cause de l’écologie, de la paix, de la justice sociale jusqu’aux logiques institutionnelles qui acccompagnent les nominations au Collège des Cardinaux… Le Pape semble concevoir la totalité de son action pour montrer qu’il existe une Église universelle et pas une collection d’Églises nationales.
Cette ligne, cependant, révèle une contradiction qui déchire le christianisme et qui semble même préfigurer une crise schismatique.
Ce pape est attaqué par Bannon, par Salvini, par Orbán parce qu’il représente une religion contraire au césaropapisme, à la religion particulière, divisive, utilisée par les politiciens contre l’Église en ce moment. J’ai beaucoup réfléchi au sujet de la relation temporelle que le Saint-Siège entretient désormais avec la Chine. Comment est-ce possible que cela ne soit arrivé qu’avec François après soixante-dix ans de tentatives répétées ? Il se peut qu’il s’agisse d’une hypothèse lancée en l’air. Mais il me semble que ce n’est pas un hasard si ce rapprochement se produit avec un pape qui se présente, pour la première fois, comme le leader d’une religion universelle non occidentale. Il se peut que ce ne soit qu’une coïncidence, mais à mon avis, ce n’est pas tout à fait accidentel. Avec François, la religion ne fait plus partie du même système de représentations. Ses prières, le synode de l’Amazonie, la primauté du problème écologique et son idée d’une religion qui devrait prendre soin du monde entier… il y a beaucoup d’indications qui vont vers une ouverture sans précédent de l’universel au non occidental.
Et donc une opposition structurelle à l’idée d’une « Europe blanche et chrétienne », pour reprendre la formule de Viktor Orbán ?
Il faut comprendre qu’Orbán ou Salvini sont des athées pratiquants qui utilisent la religion mais qui ne se sont jamais mesurés réellement à la religion. L’utilisation du chapelet télévisé n’a rien à voir avec l’aspect religieux : c’est de la pure confiscation, une exploitation. En utilisant la religion comme moyen politique, nous nous trouvons devant du césaropapisme pur. En Europe nous pensons que nous sommes vaccinés et que le césaropapisme n’est qu’un phénomène oriental, mais le monde catholique, comme vous pouvez le voir aujourd’hui en Pologne par exemple, est souvent caractérisé par cette forme de mélange utilitariste.
Le retour au césaropapisme est une instrumentalisation de la mentalité religieuse, une régression suffisamment forte dans la politique actuelle. Je la mets en parallèle avec le processus généralisé de délégation d’autorité qui caractérise à mon avis notre moment politique.
La délégation d’autorité est-elle la caractéristique profonde du style populiste contemporain ?
Le populisme fait partie d’une tendance beaucoup plus profonde et beaucoup plus dangereuse : la délégation du pouvoir. Partout dans le monde, on assiste à une évolution vers une impressionnante délégation d’autorité, vers le haut. Pour ma part, c’est ma vraie peur. Des Philippines où l’on tue sans procès, à l’Inde de Modi qui est de plus en plus autoritaire, au Brésil, en passant par la Chine, l’Inde, le Pakistan, les Républiques d’Asie centrale, la Turquie, la Russie, la Pologne, la Hongrie, les États-Unis, l’Australie, sans même énumérer tous les pays africains et tous ceux que j’ai oubliés, on assiste à une délégation de pouvoirs vers le haut.
Comment expliquer ce phénomène ?
La complexité grandissante de la vie institutionnnelle au sein des pays démocratiques, la multiplication des partis, la difficulté de former un gouvernement, la lenteur de la prise de décision font que les citoyens finissent par croire que la démocratie est un système insuffisant. En ce sens je suis impressionné par le rôle de la Chine. Les interminables discussions que j’ai eues en tant que président du Conseil italien ou en tant que président de la Commission commençaient toujours par un rite presque apologétique, où on nous demandait de la compréhension : « vous devez nous comprendre, nous sommes un pays en développement », il y avait cette rhétorique constante du pays en transition. Mais cette transition n’a pas eu lieu.
N’y a-t-il pas eu un changement profond en Chine ?
Pékin est l’opposé de Palerme. Dans Le Guépard, tout doit changer afin que rien ne change. A Pékin, c’est exactement le contraire : tout doit être absolument ferme, immobile au sommet pour que tout puisse changer. C’est à mon avis la meilleure synthèse de la doctrine Xi, la formule la plus aboutie pour comprendre notre crise politique.
En quel sens ?
Le moment clef pour comprendre notre période historique est le XIXe Congrès du Parti et le discours de Xi avec ce passage retentissant : « nous délivrons et vous, démocraties libérales, vous ne savez plus délivrer ». C’est le point symbolique d’un changement qui fait date : selon Xi, l’avenir ne sera pas seulement géographiquement situé en Asie, on peut aussi envisager qu’il soit porté par ses institutions. Et la transformation d’un système démocratique en autre chose à laquelle nous assistons est un corollaire de cette idée.
Comment définissez-vous cette transformation ?
Certains analystes parlent de démocratie illibérale ou de populisme, mais pour moi, l’élément structurant de cette crise est tout simplement une délégation ascendante, constante et croissante de pouvoirs.
Comment expliquez-vous ce phénomène ?
La première cause dans l’absolu est l’inégalité. Il y a quarante ans, j’ai écrit un article dans lequel j’analysais de façon très critique la différence de salaire au sein des entreprises du Nord de l’Italie. Seulement, la différence de salaire entre l’ouvrier et le patron se situait alors dans un rapport d’1 à 30 alors qu’aujourd’hui, elle est de 1 à 300… Nous avons sapé les fondements de la solidarité ! C’est aussi le cas parce que la façon dont la mondialisation s’est faite, qui a apporté des avantages évidents, a engendré de l’insécurité. Nous ne vivons pas avec une carte du monde ou une calculatrice dans la tête. Nous avons anéanti notre système économique, notre système d’aide sociale, sans trouver d’organismes de protection ou de médiation. L’obsession de l’immigration est liée à cette crise d’insécurité.
Que faut-il changer ?
Nous devons commencer par l’inégalité. Les gens ne se sentent plus protégés. J’utilise le mot « protection » presque comme une provocation, pour donner un sentiment d’isolement et de peur dans lequel se trouvent de plus en plus de citoyens. Il doit être compris dans le sens le plus noble du terme. Nous votons aussi pour nous sentir membre d’une communauté capable de distribuer une certaine forme de solidarité en fonction de certains éléments de justice qui, s’ils sont violés, perturbent la vie des individus. Bien sûr, l’innovation technologique aide beaucoup à créer ce malaise. Il y a des personnes qui dominent et contrôlent la technologie, qui sont heureux d’évoluer dans ce monde et qui sont bien payés, mais il y a aussi le reste des citoyens.
C’est pour cette raison, sans doute, que c’est aux États-unis, au sein de la puissance qui dirige la grande transformation technologique contemporaine, que nous trouvons la crise plus évidente d’une démocratie libérale. À cet égard, l’Union, après tout, résiste, nous sommes toujours le rempart de la démocratie libérale. Mais il nous sera difficile de continuer dans le cadre de ce système politique, qui est pour moi l’engagement de ma vie. Sans revenir à la division impériale ou à la nostalgie, nous devons trouver un moyen d’évoluer, sinon, l’autoritarisme, la délégation du pouvoir, l’emportera et nous serons écrasés.
D’où commencer ?
Ce qui m’intéresserait le plus pour l’Europe de demain, c’est la mise en œuvre du plan d’investissement social de la commission que j’ai présidé. C’est une chose énorme, très simple à mettre en œuvre, réellement faisable. De la politique continentale avec un impact réel et concret sur des volets essentiels : éducation, santé, logement. L’Europe fournirait les ressources aux régions et elles décideraient comment les engager, en rééquilibrant notre continent territorialement terriblement déchiré.